|
L’exemple de l’habitat groupé
par
Jean-Michel Longneaux
Quel(s) rapport(s)
existe-t-il entre l’habitat et l’utopie?
Aujourd’hui, pour le
commun, l’utopie en matière d’architecture (et d’urbanisme) désigne
l’approche futuriste de l’organisation de l’espace et de
l’habitat. Au nom d’une vague idéologie (l’écologie par
exemple), d’une esthétique avant-gardiste et d’une fascination pour
les progrès de la domotique et des nouveaux matériaux, on se plaît à
imaginer ce que pourrait idéalement devenir notre environnement.
Concevoir l’habitat groupé (ou communautaire) dans cette optique,
comme utopie pour le troisième millénaire, c’est demander aux
architectes de dessiner des scénarios qui relèvent davantage de la
science-fiction. Pourtant, tout comme l’art de l’habitation en général
ne saurait trouver sa vérité dans de telles rêveries, l’utopie ne
saurait être confondue avec des fantaisies «high-tech».
Nous voudrions montrer qu’approcher l’habitation par le biais
de l’utopie est beaucoup plus fondamental qu’il n’y paraît de
prime abord. L’utopie concerne l’art d’habiter et donc, notamment,
l’habitat groupé. Elle les concerne toutefois d’une façon
particulière : loin de conjuguer l’habitation au futur,
l’approche utopique consiste en effet à la déterminer dans son présent,
dans ce qu’elle est d’essentiel pour tout être humain.
Afin d’approfondir ce lien entre habitat et utopie et d’en
faire ressortir les enjeux, nous procéderons comme suit : premièrement,
partant de la définition classique de l’utopie, nous montrerons
comment la question de l’organisation de l’habitat – et notamment,
de l’habitat communautaire – s’est posée au fil des siècles.
Dans un second temps, nous ferons le chemin inverse : partant de la
question «qu’est-ce qu’habiter pour un être humain?», nous tâcherons
de voir en quoi ce geste banal mais vital relève, en son essence, de
l’utopie.
L’utopie et l’idéal communautaire
Le mot «utopie» a été forgé par Thomas More (1516) et désigne
à l’origine une île sur laquelle règne un gouvernement idéal. Le
sens exact de ce mot est difficile à définir car sa composition,
à partir du grec, est ambiguë. Soit on y voit «eu-topos», ce qui
signifierait le «lieu heureux», soit on y voit «ou‑topos» et
en ce cas, le mot signifie «l’endroit de nulle part, qui n’existe
pas». Il semble bien que Thomas More ait volontairement joué sur cette
équivoque. Quoi qu’il en soit, par la suite, la tradition
philosophique va s’emparer de ce terme et l’utiliser pour désigner
toute tentative philosophique qui reproduit d’une façon ou d’une
autre la démarche intellectuelle de Thomas More. Le mot utopie en vient
donc, aujourd’hui, à désigner un genre littéraire, et plus précisément
une manière de faire de la philosophie politique et sociale. Celle-ci
procède en trois temps : premièrement, elle dépeint les misères
sociales de son époque ; deuxièmement, elle cherche à identifier
la (ou les) cause(s) qui seraient à l’origine de ces souffrances ;
et troisièmement, elle tente de réorganiser complètement la société,
de la façon la plus plausible qui soit, en ayant pris soin de
neutraliser les facteurs jugés nuisibles. Tous les secteurs de la vie
quotidienne sont ainsi revisités et redéfinis. C’est dans le cadre
de cette conception idéale de la société qu’on en vient à reconsidérer
l’architecture et l’aménagement de l’habitat.
Il est à noter que l’utopie n’est pas qu’un exercice de
pensée. Plusieurs projets se sont traduits dans les faits. En voici
trois exemples parmi tant d’autres, où l’on voit que l’idéal, en
ce qui concerne l’habitat, est à chaque fois la forme communautaire.
Dans son ouvrage intitulé «L’Utopie», Thomas More dépeint
l’Angleterre du début du XVIe siècle. Le tableau est plutôt
sinistre : règne de la violence, corruption, triomphe de la loi du
plus fort, etc. A l’origine de tous ces troubles, Thomas More place le
pouvoir et l’argent qui, ensemble, entraînent l’exploitation des
plus faibles. C’est ainsi qu’il en vient à concevoir la cité idéale,
qui existerait sur l’île d’Utopie : celle‑ci ne connaît
ni l’argent ni la propriété privée. Du coup, son principe est
simple : elle s’organise autour d’une vie communautaire entièrement
transparente. On notera, comme caractéristiques spécifiques, la
rotation des travaux (de la ville aux champs et vice versa),
l’organisation collective des différentes tâches, les repas pris à
plusieurs familles, etc. Concernant les maisons, celles‑ci
n’appartiennent à personne en particulier et elles sont constamment
ouvertes (absence de serrure). L’utopie de More a trouvé de
nombreuses applications, moyennant quelques aménagements. Parmi les
exemples les plus frappants, on peut citer les communautés américaines
du XIXe siècle ainsi que les kibboutz en Israël : dans les deux
cas, les familles existent comme unités sexuelles mais pas comme unités
économiques ni d’éducation ni de ménage. D’autres réalisations
peuvent être citées : la «Cecilia» en Italie et au Brésil, les
villages «Harmony» fondés par Robert Owen, puis, en 1950, les
communautés de travail françaises.
La société que Charles Fourier décrit au début du XIXe siècle
(cfr. le Traité de l’unité universelle et Le nouveau monde
industriel et sociétaire est celle du capitalisme où triomphent
l’individualisme et les inégalités sociales. Il s’indigne devant
la misère et l’exploitation des plus démunis. Cherchant à
comprendre, il en vient à accuser la «propriété», ou plus
exactement «l’instinct de propriété» ; c’est lui qui est à
l’origine du malheur des hommes. On se souvient de son exclamation :
«la propriété, c’est le vol!». Mais on ne peut se contenter de dénoncer ou
de s’indigner, il faut essayer de changer les choses. Or, Fourier est
convaincu que pour ce faire, il ne suffit pas de partager les biens et
les tâches : il faut attaquer le mal à la racine. Là où
l’instinct de propriété résiste, c’est dans le mariage. C’est là,
en effet, qu’est consacrée la «possession» à usage privé des
femmes par les hommes. Que, dans un souci égalitaire, cette possession
soit réciproque ne change rien à l’affaire. C’est donc ce dernier
maillon qu’il faut faire sauter. C’est ainsi que Fourier va
concevoir son utopie (cfr le Nouveau Monde amoureux) : la société
heureuse aura pour principe la vie en communauté et pour règle
l’omnigamie. Celle‑ci consiste à promouvoir la libre
circulation du désir sexuel, ce qui implique que soit pulvérisée la
cellule familiale et conjugale. En d’autres termes, les gens se réunissent
par communauté de passion. Ce nouvel ordre sociétaire impose
l’organisation d’un nouvel habitat : ce seront les Phalanstères
I mais plus encore les Phalanstères II, construits en cercle, avec des
salles de «liens universels» qui relient la vie domestique, la
vie publique et la vie laborieuse de la Phalange, permettant surtout la
libre circulation du désir. Un tel projet se concrétisera aux
Etats-Unis : le Père Noyes fondera la communauté Oneida qui
durera plusieurs décennies.
Alors qu’elle est incarcérée, Ann Lee (XIXe siècle) a une
soudaine illumination. Il lui est révélé que les souffrances du monde
ont pour origine le péché originel identifié à l’acte sexuel.
C’est dans la chasteté que les hommes et les femmes trouveront leur
perfection. La société pleinement accomplie sera donc agamique :
ni mariage, ni sexualité. Concrètement, hommes et femmes vivent
toutefois ensemble, dans la plus parfaite chasteté, et adoptent des
enfants orphelins. Pareille communauté, de type monacal, se concrétisera
dans la société «shaker», sous la forme de villages communautaires
(on en compte une vingtaine durant plus d’un siècle) implantés par
Ann Lee elle-même dans le nord des Etats-Unis. L’organisation
spatiale est particulière : dortoir, réfectoire, chapitre, etc.,
avec une clôture «invisible» entre hommes et femmes.
Il apparaît clairement, à travers ces quelques exemples,
qu’une utopie ne doit pas être limitée au discours idéaliste d’un
rêveur en chambre (ou en prison, dans le cas de Lee) : font partie
de sa définition les tentatives de concrétisation sur le terrain, à
travers une organisation minutieuse, impliquant, comme on l’a brièvement
suggéré, des aménagements architecturaux.
Y a-t-il aujourd’hui de nouvelles utopies prometteuses ?
On peut au moins constater un peu partout en Europe un actuel regain
d’intérêt pour les habitats groupés ou communautaires (cfr. les
projets Abbeyfield, les habitations intergénérationnelles, les
fermettes «communautaires», les quartiers communautaires, etc.).
Ainsi, on doit se demander si, derrière ces initiatives, se cache une
utopie au sens où nous l’avons entendu jusqu’ici. Il importe peu de
savoir si les différents acteurs qui soutiennent de tels projets ont
conscience de s’insérer dans cette dynamique des utopies : ce
serait précisément le rôle du philosophe ou du sociologue d’en
faire prendre conscience.
Sans forcer, on peut facilement retrouver dans les initiatives
contemporaines les trois étapes qui caractérisent toute utopie. Tout
d’abord, il y a, sous-jacente, et parfois à un état larvé, une
critique de la société telle qu’elle se développe aujourd’hui. On
lui reproche d’atomiser les individus, de les isoler toujours
davantage en les condamnant, sous couvert d’autonomie, à une solitude
de plus en plus étouffante. Les liens entre les différentes générations
se diluent ; les personnes âgées, de plus en plus nombreuses,
sont délaissées ; les parents n’ont plus le temps ou l’énergie
de s’occuper de leurs enfants, etc. Les solidarités spontanées s’émiettent
et sont remplacées par des interventions de professionnels, dans le
cadre d’une relation client-expert (même les soins de santé ou
l’aide sociale se calquent sur ce modèle). Ensuite, la cause :
il semble qu’il faille chercher du côté d’un certain libéralisme,
lorsque celui-ci n’a pour devise que les lois du profit, à
l’exclusive de toute autre valeur. Les différentes initiatives
actuelles auxquelles on a fait allusion ne rentrent pas nécessairement
en croisade contre l’économie libérale. Là n’est pas directement
leur propos. Mais elles constatent une dislocation du lien social et,
suivant en cela nombre de sociologues, elles en attribuent la
responsabilité à l’omniprésence de l’économie libérale qui
sacrifie tout à sa propre logique, imposant ses propres valeurs
(rentabilité, efficacité, consommation, etc.). Enfin, troisième
moment, la solution proposée : recréer du lien là où il fait défaut,
revaloriser la vie en communauté et les solidarités de proximité.
Evidemment, ni les idées, ni les slogans, ni même la bonne volonté ne
suffisent. Si l’on ne veut pas que la solidarité reste un simple mot,
il faut que sur le terrain, elle puisse se concrétiser. L’aménagement
du territoire s’impose donc (à titre de condition de possibilité
ou d’aboutissement, de concrétisation de cette vie commune) :
organisation de l’espace, agencement de bâtiments groupés, lieux de
vie commune, commerces de proximité, etc. Si les HLM des banlieues sont
aussi, d’une certaine façon, des habitats groupés, on voit que ce
qui les distingue des projets dont nous parlons ici, c’est précisément
qu’en ce qui les concerne, ils ne renvoient à aucune utopie digne de
ce nom.
On est toutefois en droit de se demander si cette lecture n’est
pas quelque peu artificielle et même, à certains égards, contestable.
En effet, il n’est pas évident, de prime abord, que les mouvements en
faveur d’une vie communautaire relèvent nécessairement d’une
utopie, impliquant une prise de distance à l’égard de la société.
Ne peut-on pas envisager, au moins à titre d’hypothèse, une tout
autre lecture, selon laquelle ces mouvements s’inscriraient tout à
fait dans l’air du temps? Loin de «contester» la société
contemporaine et de se proposer comme solution possible pour résoudre
ses contradictions et ses misères, ils en procèderaient et même
-pourquoi pas?- les renforceraient. Ainsi, le «souci de soi» est
devenu, depuis une vingtaine d’années au moins, un trait déterminant
de nos sociétés : ce n’est plus tant faire son devoir ni réussir
professionnellement dans la vie qui donnent sens à son existence :
c’est plutôt l’épanouissement de soi ou, si l’on préfère, la réussite
de sa propre vie. Une étude un peu poussée montrerait très
probablement que toutes les alternatives, notamment en matière
d’habitat, jouent cette carte de l’épanouissement, du bien-être,
du bien-vivre, etc. Mais ce n’est pas tout. Car de cette tendance à
se recentrer sur soi et ses besoins, il résulte notamment une explosion
des valeurs et des modèles. Aujourd’hui, il n’y a plus de repères
qui devraient valoir pour tous : chacun ayant à réussir sa propre
vie (singulière et donc différente de tout autre), on est amené à
forger ses propres valeurs, à inventer son propre style de vie, et ce
dans tous les domaines de l’existence : ce qui vaut pour les
autres ne vaut plus nécessairement pour soi. On cite souvent, à titre
d’exemple, l’éclatement du modèle familial. Certes la famille est
une valeur importante, l’une des premières selon des sondages récents.
Toutefois, aujourd’hui, on ne sait plus trop à quoi doit ressembler
une famille. Chacun est invité à l’inventer, d’où l’explosion
des styles : familles monoparentales, familles nucléaires, familles décomposées
et recomposées, familles avec parents homosexuels, familles
communautaires, etc. Serait-il absurde d’affirmer que les nouveaux
projets d’habitation, quels qu’ils soient, sont aujourd’hui
envisageables et envisagés précisément pour cette même raison :
non pas pour contester quoi que ce soit dans la société, comme le
faisaient les utopies classiques, mais parce qu’aujourd’hui, dans
tous les domaines, on doit inventer et personnaliser sa manière de
vivre? Ainsi, ce serait parce que la société permet les alternatives,
et même les favorise – dans une dynamique qui se confond souvent avec
celle de la consommation du «toujours nouveau» – que des projets
innovateurs, notamment dans l’art d’habiter, voient le jour.
Bref, les habitats groupés, au même titre d’ailleurs que tous
les projets «avant‑gardistes» récents dans l’art d’habiter,
relèvent-ils de la logique des utopies sociales (rêve d’autre chose)
ou bien ne sont-ils que l’expression d’un conformisme plat (effet de
mode)? Certes, on pourrait conclure, notamment à la suite de E.
Mounier, que toute initiative humaine est fondamentalement ambiguë :
conformiste et utopique à la fois. Il serait donc vain de vouloir
trancher et même dangereux de le faire, car ce serait nier la tension
qui anime tout véritable projet. A ne vouloir que le conformisme, on
annulerait jusqu’à l’idée de projet : on n’aurait plus que
la répétition du passé ; à ne vouloir que l’utopie, dans le
sens du radicalement neuf, on se trouverait, comme l’avait vu Sartre,
devant une œuvre totalement incompréhensible parce que complètement
étrangère à l’époque de ceux qui doivent la «comprendre». En
tant que phénomène de société, les nouvelles initiatives en matière
de logement sont donc, de façon probablement indépassable, ambiguës.
Il reste toutefois que l’art d’habiter n’est pas qu’un phénomène
social. Il concerne également les individus eux-mêmes. De ce point de
vue, qui est celui d’une anthropologie philosophique, que signifie «habiter»?
Et toujours à ce niveau, y a-t-il encore un sens à rapprocher
l’habitat de l’utopie?
Habiter : l’utopie du « je »
Nous nous inspirons ici librement des quelques pages que E. Lévinas
a consacrées dans « Totalité et Infini » à la demeure
(Phaenomenologica, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, Boston,
Londres, 1980, pp. 125‑149). Son approche est phénoménologique :
ayant congédié toute théorie, elle consiste à prendre pour point de
départ l’objet (la maison) tel que nous le vivons, pour en proposer
une description rigoureuse. Or, précisément, si l’on s’en tient à
décrire cet objet particulier qu’est une maison, on est très
rapidement amené à dire que, du moins dans notre vie, cet objet ne se
donne pas comme n’importe quel autre objet. Certes, la maison est bien
un objet occupant un certain volume, ayant des murs, des portes, des fenêtres,
ou, au minimum, un toit. Mais une telle description passe sans doute à
côté de l’essentiel, qui fait d’une maison une maison. Pour
rejoindre cette «essence», il ne suffit pas de préciser que cette
chose-là dans le monde, parmi les autres choses qui nous entourent,
aurait une fonction particulière qui est de nous protéger du froid et
de la pluie, un peu comme un marteau sert à enfoncer des clous et une
voiture à nous déplacer. La maison n’est pas à proprement parler un
objet, un outil situé dans le monde : il est certes un objet du
monde, mais qui a ceci de spécifique – et c’est là qu’est
l’essentiel – que c’est à partir de lui que l’on va dans le
monde. La maison est donc certes du monde, mais sans en être :
moins objet du monde qu’accès au monde ou que porte d’entrée sur
le monde. La maison, pour le dire encore autrement, est une intériorité
qui nous ouvre sur le dehors et, avant cela, une intériorité à partir
de laquelle il y a pour nous quelque chose comme un dehors.
Si la maison est cette intériorité à partir de laquelle on
s’ouvre sur le monde, c’est qu’avant de nous ouvrir ainsi sur le
monde, la maison nous en sépare pour en quelque sorte nous mettre face
à lui, et nous le faire ainsi apparaître comme ce qui est là dehors
et qui nous entoure. Or, ce mouvement de séparation qui consiste à
nous arracher au cours du monde pour nous situer comme «hors de lui»,
face à lui, différent de
lui, n’est pas un mouvement anodin : c’est très exactement le
mouvement par lequel nous nous constituons comme sujet. Etre sujet, en
effet, ce n’est rien d’autre, pour nous qui sommes d’abord de ce
monde, que nous arracher à lui, pour nous ressaisir et nous tenir en
nous-mêmes, au cœur de notre intériorité, différent de lui et des
autres. Il n’y a donc de subjectivité que par l’œuvre d’une séparation,
d’un recueillement en soi. Dans la mesure où nous ne sommes pas de
purs esprits mais des êtres de chair et de sang, cette séparation ne
saurait être seulement «spirituelle» ni même psychologique, elle
doit s’accomplir aussi sur le plan «physique» ou matériel.
L’essence de l’habitat tient précisément dans ce rôle :
permettre à cet arrachement, cet isolement «physique» de se produire,
en le concrétisant au niveau de notre chair. Nous sommes, dans notre
corps, mis à distance du monde.
Pour s’en convaincre, on prendra trois exemples a contrario.
Premièrement, le témoignage d’anciens SDF : en les écoutant,
on est surpris de les entendre dire qu’en étant privés de domicile,
ils ont perdu peu à peu le sentiment d’être une personne ou un
sujet. Nulle part chez eux, ils n’avaient plus la possibilité d’être
quelqu’un qui se tient face au monde ; ils se sentaient bien plutôt
perdus dans ce monde, chose parmi les choses, menacés constamment,
tributaires des événements du monde. Manifestement, le fait de perdre
son domicile fragilise la subjectivité, jusqu’à l’annihiler, réduisant
la personne à n’être plus qu’un objet parmi les objets. C’est précisément
ce que l’on observe en cas de guerre et c’est là notre second
exemple. Pourquoi, en effet, les envahisseurs détruisent-ils systématiquement
les maisons des territoires conquis ? Pour effrayer les populations
civiles? Pour les chasser de chez elles? Par vandalisme? Par sadisme?
Pour se venger? Sans doute, tous ces motifs interviennent-ils. Mais plus
fondamentalement, en détruisant les maisons, les envahisseurs tentent
de détruire la subjectivité des personnes visées, pour les réduire
à l’état d’objets, à la merci d’un monde désormais sans refuge
pour eux. En d’autres termes, c’est une façon de dire (et de faire) :
«vous n’êtes plus rien d’humains». Troisième exemple :
certains acteurs sociaux se sont inquiétés, voire indignés, en découvrant
des personnes âgées vivre dans de véritables taudis : pas
d’eau chaude, électricité précaire, W.C. à l’extérieur,
moisissures, etc. Au regard des normes de sécurité, au regard des
normes de santé, il s’imposait de reloger ces personnes âgées dans
des maisons accueillantes, bien chauffées, etc. On sait qu’à la
suite de tels déménagements, plusieurs sont rapidement décédées. La
question est de savoir pourquoi. On pourra toujours avancer qu’elles
étaient vieilles, de santé précaire et de toute façon à la fin de
leur longue vie. Pourtant, on ne peut pas s’empêcher de se demander
si de tels déménagements n’ont pas précipité leur décès, comme
si on les avait déracinées, comme si, les couper de leur «chez elles»,
c’était les couper d’elles-mêmes, de leur histoire, en un mot, de
leur vie. Le «chez soi»
est souvent plus vital que toutes les normes (somme toute justifiées)
de sécurité.
Habiter, c’est donc, pour l’être humain, se positionner
comme sujet de sa vie, face au monde, en se séparant de lui. Tout ceci
semble nous éloigner de la question de l’utopie. Or, c’est précisément
au moment où il résume son propos que Lévinas réintroduit ce thème,
d’une façon pour le moins déconcertante. Il écrit, en effet :
«la fonction originelle de la maison ne consiste pas à orienter
l’être par l’architecture du bâtiment et à découvrir un lieu –
mais à rompre le plein de l’élément, à y ouvrir l’utopie où le
«je» se recueille en demeurant chez soi» (p. 130).
Que peut signifier «ouvrir l’utopie où le je se recueille en
demeurant chez soi»? La citation de E. Lévinas n’étant que prétexte
à réflexion, nous ne chercherons pas ici à proposer un commentaire
serré de la pensée dans laquelle elle s’insère. Nous nous
contenterons de quelques libres considérations, qui prolongent notre
analyse. Précisément, nous avons vu que le mot «utopie» avait, par
son étymologie ambiguë, un double sens : «le lieu qui n’est
nulle part» et «le lieu heureux». Si l’on s’en tient à une phénoménologie
de la subjectivité, si l’on tente de décrire simplement comment se
donne à nous le «je» – en philosophie, on dit le «Soi» – qui
est nôtre (en dehors de toute théorie psychologique ou
neurobiologique), on est amené à constater, premièrement,
qu’il est sans lieu. On peut tenter de le situer quelque part
dans notre corps, dans les yeux, dans le cerveau ou dans le cœur, comme
on voudra : une fois qu’on ira voir, ce n’est pas un «Soi»
mais seulement des organes qu’on trouvera. Le «Je» n’est pourtant
pas une illusion, nous en faisons constamment l’expérience et, plus
exactement, nous le sommes. Simplement, ce «Je» que nous sommes est le
«ici», le point de départ de nos actions, qui n’occupe
manifestement aucun lieu particulier. Il n’est pas une chose qui a sa
place à côté d’autres choses : impossible de mettre la main
dessus. Pour le dire autrement, l’intériorité de notre être (le Je )
n’a rien à voir avec «l’intérieur» de notre corps. Le «Je»
entretient certes un rapport indéniable avec le corps. Et pourtant, ce
rapport ne se laisse pas comprendre comme l’envers d’un lieu, sa
face cachée, son dedans. Le Soi existe mais n’est pas de ce monde :
il est pure intériorité (qui échappe à l’opposition
dedans/dehors).
Mais il ne suffit pas de constater que, bien qu’il existe, le
Soi n’est nulle part. Il faut encore se demander comment nous l’expérimentons,
comment nous savons que nous sommes un tel Soi? Nous l’avons dit, il
ne se «montre» pas comme un objet dans le monde. Enumérant les objets
qu’il y a dans la pièce où je me trouve, je ne dirai pas : il y
a la table, la chaise, mon corps, mon «Je», la fenêtre, le paysage,
etc. Si donc le Soi ne se donne pas comme un «quelque chose», comment
se donne-t-il à nous? La réponse est simple pourvu, une fois
encore, que l’on s’en tienne à notre expérience plutôt qu’aux
théories : il se donne sous la forme d’un sentiment, de ce sentiment
d’exister que nous ne cessons d’éprouver et même, faut-il dire,
que nous sommes, de telle sorte que, par lui, nous pouvons agir. Je me
sens vivre et agir comme Je. Le Je vit et agit comme sentiment. Et se
sentir, s’éprouver, c’est tout simplement jouir de soi, jouir de
son être (même si c’est sous des modes toujours changeants, allant
de la souffrance à la joie). Cette jouissance de soi qui caractérise
notre «Je» nous rapproche incontestablement du second sens étymologique
du mot «utopie», comme «lieu heureux», c’est-à-dire comme lieu où
l’on se sent, s’éprouve, où l’on est donné à soi dans un lien
indéfectible.
«Ouvrir l’utopie où le «je» se recueille en demeurant chez
soi», c’est donc ouvrir un lieu qui n’est nulle part, comme
jouissance de soi, qui permet effectivement au Je de demeurer ainsi en
lui-même. Faisant dès lors retour sur la question de l’habitat, il
ressort que celui-ci n’est pas qu’un objet, un lieu, un espace (à
usage privé) du monde, qui aurait à subir les modes architecturales et
sécuritaires ainsi que les progrès de notre époque. D’une façon
plus essentielle, on doit dire que l’habitat – même sous sa forme
la plus humble, comme la demeure des personnes âgées que nous évoquions
précédemment – a pour fonction de permettre à une subjectivité de
s’asseoir, de se poser en elle-même, de s’habiter pour prendre
possession d’elle-même. C’est en cela que l’habitat est, de façon
originelle, utopique par essence. Cet espace «intérieur», ce «chez
soi» qui n’est pas du monde, qui se soustrait à l’espace public,
à son organisation/désorganisation, à ses enjeux de pouvoir, se présente
comme lieu critique et vital qui dément que tout puisse être absorbé
dans le monde, livré à lui, soumis à ses lois, chose parmi les
choses. Certes, toute habitation épouse un style, celui de son époque.
Certes, il existe de demeures d’apparat et de prestige. Certes, on
construit des logements à caractère social. Ce qu’il faut toutefois
comprendre, c’est que réduire «l’art d’habiter» à de tels critères de
prestige, de style, de mode, d’usage social, de sécurité, etc.,
c’est ramener cet art à des considérations mondaines qui, pour
importantes qu’elles soient, occultent l’essentiel. Il faut bien le
constater, les critères énumérés (et tous ceux du même ordre) étouffent
l’»âme humaine» lorsqu’ils sont seuls pris en compte (cfr les
HLM) : parlant des maisons construites dans cette optique, on dira
d’ailleurs, de façon évocatrice, qu’elles sont sans âme. Si
l’on doit néanmoins tenir compte des exigences de sécurité, de
mode, etc., ce sera en les repensant à partir de ce qui seul importe en
définitive : permettre à une subjectivité de s’habiter, de se
sentir chez elle.
Deux remarques s’imposent avant de conclure. Tout d’abord, en
constatant que le «Je» tient dans un sentiment, ce sentiment
d’exister comme sujet agissant, on peut faire l’hypothèse que
l’esthétique (qui vient du grec «sentir»)
est bien plus qu’une question de mode : celle-ci est
superficielle, le plus souvent, au regard de ce qui se joue dans
l’esthétique. Tandis que la mode vise le regard des autres et est, à
ce titre, un phénomène social et, aujourd’hui, commercial, l’esthétique
est, quant à elle, une expérience tout intérieure, qui donne au «Je»
de ressentir le beau, de vivre dans le beau, qui est une forme de
jouissance de soi. Si l’esthétique est une dimension essentielle dans
la vie du sujet, alors on comprend qu’elle doit occuper une place
privilégiée dans l’architecture, avant les questions de sécurité
ou de goût socialement admis par exemple (que l’on songe encore une
fois à l’exemple de nos personnes âgées qui sont chez elles, selon
leur «esthétique» même si, socialement, c’est plutôt d’un mauvais genre).
Ensuite, la lecture que nous avons donnée de l’art d’habiter
ne doit pas nous faire tomber dans le travers du cocooning, du repli
frileux sur soi, de la fuite hors du monde. Lévinas écrit tout de
suite après la phrase que nous avons commentée : «Mais la séparation
n’isole pas, comme si j’étais simplement arraché à ses éléments.
Elle rend possible le travail et la propriété». Le moment de la séparation
est indispensable dans la constitution du «Je» : il n’est
cependant pas une fin en soi. Ce n’est qu’un moment qui doit
permettre au «Je» de s’ouvrir au monde (c’est le travail, qui
permet la propriété), de même que la maison, écrira plus loin Lévinas,
est une intériorité qui doit se faire accueillante, ouverte par conséquent,
à autrui.
Conclusion : habitat groupé et utopie sociale
Une fois que l’on a cerné le lien profond qui unit
l’habitat, l’utopie et le Soi, on peut alors reprendre la question
de l’utopie sociale, c’est-à-dire de l’utopie au sens où nous
l’avions tout d’abord abordée. L’habitat a pour fonction de nous
arracher au monde pour nous permettre de nous positionner comme un Je
face à lui. La question est de savoir quel est ce monde duquel on
s’arrache. S’agit-il de la nature, de telle sorte que le mouvement décrit
par Lévinas consisterait en définitive en un passage de la nature à
la culture? Sans doute, mais on peut aussi faire l’hypothèse que le
monde duquel on se sépare est également un monde que l’homme s’est
déjà réapproprié. Ici, les descriptions sont multiples. Nous en
retiendrons, quant à nous, deux caractéristiques déjà évoquées,
qui en font un monde particulièrement inhospitalier. Premièrement, il
est soumis aux lois d’une économie pour le moins impersonnelle et
deuxièmement, cette économie est de plus en plus mondialisée :
dans les deux cas, le monde n’est plus un monde à taille et à visage
humains.
Se poser comme «Je», c’est donc, dans le moment critique que
nous avons décrit, s’arracher notamment à ce monde-là, le mettre à
distance et donc en question, pour en faire précisément un monde qui,
en tant qu’impersonnel, ne peut pas être le mien. L’habitat, qui
est la dimension concrète de cet arrachement, est le symbole qui témoigne
à sa façon que tout n’est pas soumis à ce monde, que tout ne s’y
résorbe pas. Mais une fois que l’on s’est réapproprié sa propre
vie en s’étant ainsi recueilli en soi, dans son «chez soi», on ne
peut éviter de retrouver le monde pour le réinvestir. Poursuivant la réflexion
de Lévinas, ce qu’il appelle le travail, c’est cela :
s’ouvrir sur le monde et le travailler pour l’humaniser et dans le
cas de figure qui est le nôtre, pour le ré-humaniser, c’est-à-dire
le faire nôtre. C’est là, à notre avis, qu’interviennent les «projets
communautaires» comme utopies sociales. Ceux-ci ne visent pas tant à
contester l’individualisme que l’anonymat et le caractère
impersonnel du monde. Dans la plupart des cas, en effet, il s’agit de
réintroduire du relationnel à taille humaine (de telle sorte qu’il
ne faut plus dire »la terre est un village» mais «la terre est
une fédération de petits villages»), simplement par la réorganisation
de notre milieu et, notamment, de notre façon d’habiter. L’habitat
groupé préserve donc le «chez soi» dont a besoin toute personne,
mais l’ouvre en même temps sur un environnement immédiat à visage
humain, puis, à partir de là, tente de rayonner. De telles initiatives
ne doivent pas être sous-estimées. On peut y voir une douce révolution
qui bouleverse les trois fondements de notre société : l’économie,
comme nous l’avons évoqué, mais aussi la justice et la santé. Nous
en dirons juste un mot.
Pour ce qui est de l’économie, le mouvement instauré par les
projets communautaires va manifestement à l’encontre d’une économie
qui tend à se mondialiser. On redécouvre l’intérêt d’une économie
de proximité, que les hommes maîtrisent. On songera, dans certains
pays d’Amérique du Sud, à ces espèces de «conseils de
participation» où l’on voit l’ensemble d’un village discuter de
la gestion économique de leur région. Chez nous, des expériences
comme le SEL – une économie parallèle basée essentiellement sur le
troc de services entre personnes – témoignent aussi de ce besoin de
se réapproprier les lois de l’échange et peut-être plus encore, de
rattacher la valeur du travail à l’effort concrètement fourni. Dans
les pays du nord de l’Europe comme le Danemark, des expériences sont
en cours, où l’on développe des quartiers «communautaires» qui
articulent des habitats groupés avec une foule de petits services qui
facilitent la vie : création de petits commerces, pharmacie,
garderie, blanchisserie, restaurant, etc. L’enjeu n’est pas nécessairement
de renverser l’économie dominante, mais de rendre possible, à côté
de celle-là, une autre économie, basée résolument sur une solidarité
de proximité (contre les grandes solidarités anonymes organisées par
l’Etat, et qui se traduisent, sur le terrain, en rapport impersonnel
de client à professionnel).
Concernant la justice, on songera ici à la sécurité : le
mode de vie induit par les habitats groupés renforce indéniablement le
sentiment de sécurité. Ainsi, ce n’est pas un hasard si le public
visé et qui se montre effectivement intéressé par de tels projets
regroupe notamment (mais pas seulement) des personnes qui ont
naturellement un plus grand besoin de protection ou de soutien, tels les
familles fragilisées, les enfants, les personnes à autonomie réduite,
les personnes âgées, etc. Toutefois, deux remarques s’imposent. Tout
d’abord, il ne faut pas s’illusionner : la vie en communauté
n’est pas synonyme de vie entièrement pacifiée. Au contraire, une
telle vie est également source de tension, de rivalité et parfois de
violence. Simplement, on peut constater que le recours à une justice
impersonnelle et procédurale est moins fréquent du seul fait qu’ici,
les personnes en conflit se connaissent. La négociation, la médiation,
dans un tel contexte, sont beaucoup plus aisées à mettre en place. En
d’autres termes, ce n’est pas à une disparition des conflits que
l’on assiste – ils font partie de la vie et aident parfois à «grandir»
–, mais à leur «humanisation». Deuxième remarque, dans le souci de
maximaliser la sécurité, le danger qui guette les projets
communautaires est la tentation de former des ghettos coupés du monde
extérieur, comme on le voit aux Etats-Unis avec les personnes âgées.
Il faut rappeler, suite à ce que nous avons vu, que l’ouverture sur
le dehors reste un élément essentiel à toute forme d’habitat
authentique.
Troisième pilier de notre société, la santé. Les projets
communautaires mettent l’accent sur la santé. Il ne s’agit pas
simplement de prétendre qu’en vivant dans un environnement à visage
humain, on ne peut que ressentir un véritable sentiment de bien-être,
qui améliore incontestablement la qualité de vie. Les observations
actuelles tendent à montrer qu’un tel mode de vie a une véritable
influence sur la santé. Ainsi, même si les maisons Abbeyfield
n’acceptent à l’entrée que des personnes âgées en bonne santé,
il est étonnant de constater que celles-ci gardent jusqu’à la fin de
leur vie un degré d’autonomie nettement supérieur à la moyenne.
Autre exemple : celui de la petite ville de Roseto. Cette ville des
Etats-Unis était suivie par les scientifiques car elle se distinguait
étrangement de deux autres villes proches et semblables, par son faible
taux de décès par infarctus. Or, dans les trois villes, on observait
le même nombre de fumeurs, une alimentation similaire et un taux de
diabète identique. La seule différence relevée par les chercheurs était
la suivante : la ville de Roseto avait un mode d’organisation
communautaire, les deux autres pas. Plus étonnant encore : lorsque
dans les années septante, de par son extension, la ville de Roseto dut
renoncer à son mode de vie, on a vu augmenter le nombre de décès par
infarctus. Ces observations et d’autres tendent incontestablement à
relativiser la médecine traditionnelle. Même si celle-ci se veut
davantage attentive à la personnalité et à l’histoire du patient,
l’accent est toujours mis sur une approche exclusivement scientifique
du somatique : la maladie reste une perturbation du corps objectif
isolé des autres corps, qui nécessite une intervention physique ou médicamenteuse.
Les approches communautaires invitent à un élargissement de cette
conception «scientifique» de la santé. Celle-ci concerne des corps en
relation.
La maison est notre point de départ dans le monde. Dans ce
mouvement par lequel elle s’ouvre sur l’extérieur, la maison est
l’occasion d’une utopie – que l’on dira sociale –, par
laquelle il s’agit de se réapproprier le monde. Organisée en habitat
groupé, la maison «incarne» une utopie communautaire qui a pour
principe la solidarité à dimension humaine. Cette utopie, dont on a
esquissé certaines applications au niveau économique, au niveau de la
justice et de la santé, n’est toutefois possible que si l’on préserve
ce qui détermine l’essence de l’art d’habiter : être
d’abord ce non-lieu qui nous arrache au monde, qui en suspend le cours
et, ainsi, nous donne l’occasion de nous recueillir en nous-mêmes,
chez nous. Toute habitation qui a une âme est ainsi, de façon
originaire, une utopie. La question n’est donc pas de savoir si,
aujourd’hui, il nous faut habiter autrement (on ne peut s’empêcher
de suspecter l’incitation au changement d’obéir à la logique
superficielle de la consommation). La vraie question est bien plutôt la
suivante : comment permettre à chacun de se sentir chez lui, pour
mieux habiter le monde?
Jean-Michel Longneaux
-------------------------------------------
Navigation
Previous / Home / Heading / Next
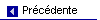 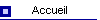  
-------------------------------------------
...https://www.habiter-autrement.org/
> Et si nous
habitions autrement
Contact pour HA: lreyam@gmail.com

https://www.habiter-autrement.org/
|
 https://www.habiter-autrement.org/
>
https://www.habiter-autrement.org/
>